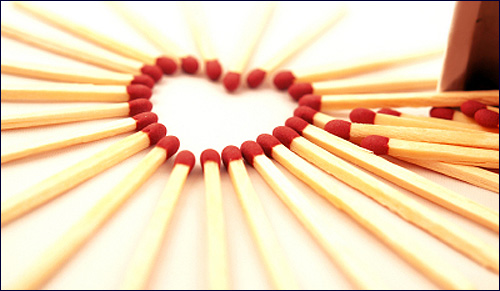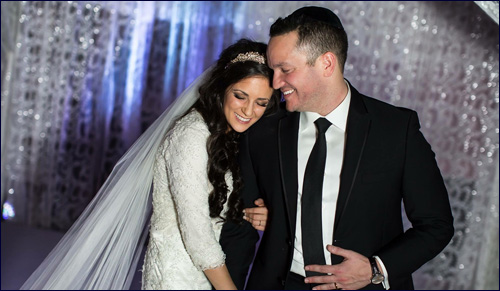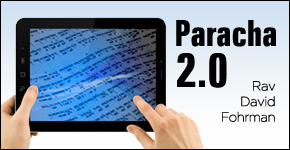Ma plus belle vengeance contre l'horreur nazie

À cet instant-là, je me fis un vœu : si je survivais à Buchenwald, je reviendrais ici pour tuer la femme du maire.
La première fois que Martin Greenfield tint une aiguille et un fil, c’était à Auschwitz, pour réparer la chemise rayée qu’un kapo nazi lui avait déchirée en le rouant de coups.
Aujourd’hui, l’ancien détenu dirige une célèbre manufacture de costumes et habille quasiment tout l’establishment américain.
Déporté de Tchécoslovaquie à l’âge de 15 ans en direction d’Auschwitz, Greenfield échappa à la tristement célèbre sélection du Dr Mengele avant d’être arraché à sa famille. À sa libération de Buchenwald, il fut le seul rescapé de toute sa famille.
En 1947, Greenfield débarqua en Amérique à 19 ans, seul et sans le sou. Simple commis dans une usine de confection new yorkaise, il gravit de fil en aiguille les échelons de son métier jusqu’à devenir un tailleur virtuose, propriétaire de la première manufacture de costumes sur-mesure des États-Unis. Il habilla plusieurs présidents américains, dont Eisenhower à qui il profita de donner quelques conseils en matière de politique étrangère en lui glissant des petits papiers dans les poches de son costume.
Dans cet extrait de sa récente autobiographie, il raconte comment l’horreur de sa vie derrière les barbelés faillit lui dérober son humanité. Et il revient sur le jour fatidique où celle-ci lui fut restituée.
La femme du maire
Quand j’étais interné à Buchenwald, les SS m’affectèrent dans une usine de munitions. Mais un certain matin, après l’appel, un soldat me transféra dans une équipe de 12 prisonniers qui effectuaient des réparations en dehors du camp, dans la ville voisine de Weimar.
La perspective de ce travail en ville fut pour moi une distraction heureuse de l’horreur des camps. Parfois, la chance nous souriait et on trouvait une pomme de terre dans un champ ou l’on parvenait à dérober une petite breloque à troquer contre de la nourriture. Quoi qu’il en fût, c’était l’occasion de voir la couleur du ciel, d’échapper à la puanteur des cadavres en décomposition, et d’attester que le monde continuait d’exister au-delà des barbelés.
Munis de nos outils, nous parcourûmes les quelques kilomètres qui nous séparaient de Weimar. Les soldats nous stoppèrent en face d’une demeure bombardée où vivait le maire de Weimar. Une imposante Mercedes était garée devant. Les soldats nous ordonnèrent de trier les décombres, de nettoyer les débris et de commencer à réparer les dégâts.
Pour ma part, je me rendis à l’arrière de la maison pour évaluer les dommages. Des piles de briques poussiéreuses étaient éparpillées à travers la cour. Voyant que la porte du cellier était ouverte, je l’ouvris avec précaution. Un rayon de soleil inonda la pièce obscure me laissant entr’apercevoir une cage en bois grillagée. En m’approchant, j’y découvrir deux lapins fébriles et apeurés.
« Ils sont vivants ! » m’exclamai-je, surpris.
Dans la cage, se trouvaient les reliefs de leur repas. Déverrouillant la cage, je sortis une feuille de laitue avariée et un petit bout de carotte. La salade était flétrie et visqueuse et la carotte humide portait encore les trace des dents des rongeurs. Fou de joie, j’engloutis la feuille de laitue et plantai mes dents dans le bout de carotte.
Mais mon ravissement fut de courte durée.
– Que faites-vous ? Hurla une voix.
Tournant la tête en direction de la porte, j’aperçus dans l’embrasure la silhouette d’une belle femme blonde tirée aux quatre épingles, un bébé dans les bras. C’était la femme du maire de Weimar.
– J… J’ai trouvé vos lapins ! Bégayai-je nerveusement. Ils sont sains et saufs !
– Pourquoi diable volez-vous la nourriture de mes lapins ? Aboya la femme. Espèce d’animal !
Pour toute réponse, je baissai les yeux au sol.
– Je m’en vais rapporter cela immédiatement, dit-elle en tournant les talons.
Dans ma poitrine émaciée, mon cœur battait la chamade. Quelques minutes plus tard, un SS m’ordonna de sortir du cellier. Je savais ce qui m’attendait, et la simple perspective ne faisait que l’empirer.
– Au sol, espèce de chien ! Vociféra le Nazi. Et plus vite que cela ! Armé de sa matraque, il me roua de coups. Je ne sais pas si la femme du maire était présente. Mais vu sa cruauté, pourquoi se serait-elle privée d’un tel spectacle ?
De retour à Buchenwald, je rejouai la scène sans arrêt dans mon esprit.
Comment une femme portant son propre bébé qui trouve un squelette ambulant venant de sauver ses animaux de compagnie put le faire rosser pour le simple crime d’avoir grignoté leur pâtée avariée ? Me demandai-je.
Je me fis un vœu : si je survivais à Buchenwald, je reviendrais ici pour tuer la femme du maire.
À cet instant, mon engourdissement face à la mort fondit. À la place, naquit une soif de sang et de vengeance que je n’avais jamais expérimentée. Et cette rage fulgurante fut un baume pour mon corps décharné.
À cet instant-là, je me fis un vœu : si je survivais à Buchenwald, je reviendrais ici pour tuer la femme du maire.
Ne tirez pas !
Le 11 avril 1945, à 15h15, les Alliés libérèrent Buchenwald.
Physiquement, j’étais un homme libre. Émotionnellement, j’étais encore enchaîné. Je m’étais fait une promesse. Et j’étais férocement décidé à la tenir.
Je rassemblai deux adolescents juifs en assez bonne forme pour faire la marche jusqu’à Weimar. Je leur confiai ce que cette femme m’avait fait et comment je comptais me venger d’elle. Nous pûmes aisément dénicher des mitraillettes dans le monticule d’armes allemandes saisies par les détenus et les Américains et qui s’empilaient sur l’Appelplatz.
À l’extérieur du camp, planait un sentiment d’angoisse et d’inquiétude. Une poignée de détenus en pyjamas rayés déambulaient dans les rues, à la recherche de victuailles. Je gardai l’œil grand ouvert au cas où un SS surgirait. Munis de nos armes, nous partîmes pour Weimar.
À mesure que nous nous rapprochions de la maison du maire, les battements de mon cœur se faisaient plus rapides. La rage et la colère accumulées à cause de toutes ces horreurs que j’avais vécues déferlèrent en moi. Tuer la femme du maire ne pourrait pas punir les Nazis pour toute la souffrance qu’ils nous avaient infligée. Mais ce serait déjà un début.
Après quelques kilomètres de marche, la maison du maire apparut devant nous. La belle Mercedes n’était pas garée devant.
Il me fallut un petit instant pour m’assurer que c’était la bonne maison.
« L’automobile n’est pas là. On dirait que la maison est vide, remarquai-je. Voici le plan : nous allons entrer avec nos armes par la porte latérale. Puis nous nous cachons en attendant que je puisse descendre la femme blonde qui m’a fait battre. »
Mes compagnons opinèrent.
Nous rampâmes jusqu’à la porte latérale. Avec mille précautions, je poussai la poignée. La porte était ouverte. Je pénétrai dans la maison en silence, mon arme dégainée. Les garçons se glissèrent derrière moi, puis refermèrent la porte derrière eux. Nous avancions à pas de loups pour que le bruit de nos sabots de bois ne trahisse pas notre présence.
— Il y a quelqu’un ? fit une voix. Il y a quelqu’un ?
Soudain, la belle femme blonde apparut devant nous et laissa échapper un glapissement. Cette fois encore, elle portait son bébé dans les bras.
— Ne tirez pas ! s’écria-t-elle. Ne tirez pas !
— Vous vous souvenez de moi, n’est-ce pas ? Vociférai-je
Ses tresses blondes tremblèrent violemment. Elle dissimula son visage de sa main levée, comme si elle cherchait à se protéger du soleil.
– Vous m’aviez fait battre à cause de vos lapins. Et maintenant, je suis là pour vous tuer ! Dis-je, sur le ton d’un SS.
Je pointai ma mitraillette sur sa poitrine. Le bébé éclata en sanglots. Mon doigt planait dangereusement sur la détente.
— Par pitié, ne faites pas cela ! supplia-t-elle. J’ai un bébé.
Je pointai ma mitraillette sur sa poitrine. Le bébé éclata en sanglots. Mon doigt planait dangereusement sur la détente.
— Descends-là ! Hurla l’un des jeunes hommes. Descends-là !
Le bras de la femme tremblait dans l’air. Mon propre cœur battait comme un marteau.
— Descends-là ! Renchérit l’autre garçon. C’est bien pour cela que nous sommes ici ! Allez !
Mais je restai immobile. Je ne pouvais pas me résoudre à cela. J’étais incapable de presser la détente. Et c’est à ce moment précis que je redevins humain. Tous les anciens enseignements qui avaient bercé mon enfance me revinrent à l’esprit. J’avais grandi avec l’idée que la vie était un cadeau précieux provenant de Dieu, que les femmes et les enfants devaient être protégées.
Si j’avais pressé la détente, j’aurais été comme Mengele. Lui aussi s’était trouvé face à des mères portant des bébés – dont ma propre mère et mon propre petit frère – et les avaient tous deux condamnés à une mort atroce. L’éducation que j’avais reçue ne me permettait pas de devenir à mon tour un membre honoraire du SS.
Et pourtant, cette compassion risquait de passer pour de la faiblesse. Aussi, je m’efforçai de sauver la face devant mes compagnons. Si j’étais incapable d’être un meurtrier, je pouvais au moins jouer les voleurs de voiture.
— Où est la voiture ? Aboyai-je.
— Elle n’est pas là.
Abaissant mon arme, je sortis de la maison.
— Tu nous as fait venir pour rien, râla l’un des garçons.
— J’étais incapable de la tuer, répliquai-je. Elle avait un bébé !
— Combien de bébés ils ont tué, eux ? Railla-t-il. Il n’avait pas tort.
Nous regagnâmes la vaste grange située à l’arrière de la maison et déverrouillâmes les lourdes portes de bois. Devant nous, dissimulée sous des balles de foin, se trouvait la grande Mercedes noir. J’étais livide. Je lui avais épargné la vie et elle osait me mentir en pleine figure.
— Attendez-moi, dis-je aux garçons.
Mon arme dégainée, je retournai vers elle : « Cette fois, je vais vraiment te tuer ! Donne-moi les clés immédiatement ! » Elle s’exécuta.
Je rejoignis en courant les garçons.
« Je les ai eues ! » dis-je en faisant tinter les clés dans ma main.
Trois rescapés des camps au volant d'une Mercedes...
— Qui sait conduire ? demanda l’un des garçons.
— Moi ! Dis-je.
Nous balayâmes la paille et nous engouffrâmes dans la voiture.
— Vite ! Sortons d’ici ! dit l’autre.
Quel spectacle avons-nous dû offrir : trois adolescents juifs en pyjamas rayés, armés de mitraillettes, au volant d’une Mercedes dans les rues de Weimar, filant en direction du camp de concentration de Buchenwald. Nous parlâmes et plaisantâmes comme des petits durs que nous n’étions pas.
Pendant un instant, j’envisageai d’abandonner l’automobile dans un fossé. Après tout, nous roulions dans la Mercedes du maire de Weimar. Si ça ne suffisait pour nous confondre, les plates d’immatriculation s’en chargeraient. Mais je me ravisai : pourquoi diable s’embarrasser de telles précautions ? Ce n’est pas de si tôt que j’aurai l’occasion de conduire une Mercedes…
Alors je roulai droit jusqu’à Buchenwald, et je franchis même les portails du camp au volant de ma Mercedes. Cette fois, l’ironie de l’inscription de fer forgé Jedem das Seine (À chacun ce qu’il mérite) s’étalant le long de la grille d’entrée principale m’arracha un sourire.
Des prisonniers s’immobilisèrent et nous observèrent tandis que nous déboulions dans le camp. Ils devaient certainement s’imaginer qu’un haut dignitaire ou le maire de Weimar en personne sortirait de l’automobile. Quand ils aperçurent nos uniformes de prisonniers, ils accoururent vers nous.
— Comment avez-vous dégoté cette Mercedes ? Nous demanda quelqu’un.
— Comme cela, ai-je répondu en souriant !
Tout au long de ma vie, j’avais entendu que tout arrive pour une certaine raison, que les voies de Dieu étaient mystérieuses, mais dotées d’un sens. J’y croyais sincèrement. Mais la suite de mon histoire me prouva qu’au bout du compte, dans cette vie ou dans une autre, Dieu finit par rendre justice.
Des années plus tard, un ami à moi me montra une coupure d’un numéro du magazine Life datant de 1945 et traitant des suicides des nazis à la suite de la guerre. En voici un extrait :
Durant les derniers jours de la guerre, l’accablante prise de conscience de la défaite fut trop dure à supporter pour de nombreux Allemands. Déchus des baïonnettes et de la grandiloquence qui leur avaient conféré du pouvoir, ils furent incapables d’affronter ni leurs conquérants ni à leurs conscience. Ils trouvèrent le plus sûr et rapide des échappatoires dans ce que les Allemands appellent Selbstmord, le suicide… Dans le Reich d’Hitler, les Allemands arrêtèrent de tuer les autres pour se mettre à se tuer eux-mêmes. À Weimar, après avoir vu les atrocités de Buchenwald, le maire et sa femme s’entaillèrent les veines du poignet.
Ce fameux jour, dans la maison du maire, Dieu titilla ma conscience. Ce faisant, il m’épargna la honte et la culpabilité de tuer la femme du maire de Weimar.
Je n’eus pas à la tuer. Elle s’en chargea à ma place.
Extrait de l’autobiographie de l’auteur “Measure of a Man: From Auschwitz Survivor to Presidents’ Tailor” et adapté par Aish.fr.