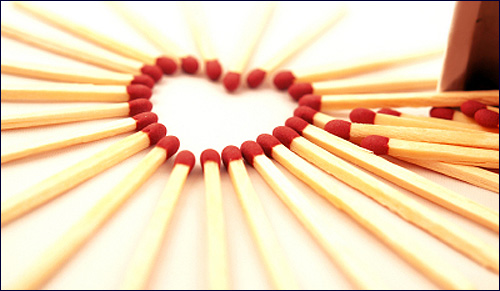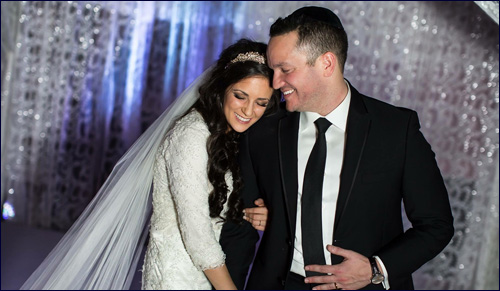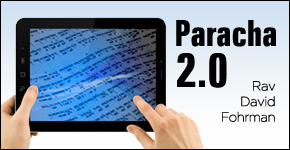Des anges et des poinsettias

Mon père ne croyait pas aux anges. C’est pourtant lui qui m’a appris comment les hommes ont le pouvoir d’en créer.
Mon père ne croyait pas aux anges. Les notions spirituelles ou les concepts métaphysiques l’ennuyaient. Mais à son décès, quand je me suis tenue à côté de son corps recouvert d’un suaire dans la pièce réfrigérée de la morgue, j’ai été submergée par la sensation qu’une légion d’anges l’entourait et escortait son âme vers l’au-delà. Quant à moi, sa fille si ardemment spirituelle, je me tenais là et enviais la place qui lui était réservée dans le monde futur.
Selon le judaïsme, les êtres humains ont le pouvoir de créer des anges. Chaque bonne pensée, parole ou action donne naissance à une force positive dans l’univers, que l’on appelle ange. Ces anges sont éternels. Ils voltigent tout autour de nous durant notre vie et nous accompagnent après notre décès jusqu’à la récompense qui nous attend. Inversement, toute mauvaise pensée, parole ou action crée un ange malfaisant, ou démon. Ceux-ci tournoient également autour de nous jusqu’à notre passage devant le tribunal céleste, où ils deviennent nos accusateurs.
Je pouvais reconnaître les visages de bien de ces anges qui peuplaient cette pièce au carrelage blanc du dépôt mortuaire. Un plein contingent avait vu le jour au cours de ces matinées pluvieuses quand mon père, allant en voiture au travail, s’arrêtait à chaque arrêt d’autobus tout au long de sa route pour y faire monter les gens qui se rendaient dans la même direction que lui.
Un peu plus loin, se trouvait l’ange aux yeux noirs que mon père avait obtenu en accostant un homme robuste qu’il avait surpris en train de voler dans sa pharmacie. Un policier qui se trouvait justement à ce moment-là dans le magasin avait appréhendé l’homme mais mon père avait refusé de déposer plainte. En échange, il avait proposé à son assaillant un emploi afin qu’il puisse rembourser les articles qu’il avait tenté de dérober.
Il proposa à son assaillant un emploi afin qu’il puisse gagner un peu d’argent.
Je reconnus un autre ange, né à la fin d’une froide journée d’hiver, alors que je rentrais en voiture à la maison avec lui. Mon père livrait chaque jour les médicaments prescrits par les médecins aux personnes qui étaient trop souffrantes pour se déplacer. Ce jour-là, j’étais très pressée de rentrer chez moi, mais mon père m’assura qu’il n’avait qu’une seule livraison à faire. Il se dirigea vers une maison délabrée dans le ghetto qu’était devenu le quartier de Camden, dans le New Jersey et y disparut. Le temps qu’il en ressorte quinze minutes plus tard, j’écumais de rage.
« Qu’est-ce qui t’a pris tellement de temps ? » lui ai-je reproché.
Mon père, qui ne se justifiait jamais, mais qui ne voulut pas subir ma harangue, me répondit simplement : « La maison était glacée. Rien d’étonnant à ce que cette femme soit tombée malade. J’ai donc essayé d’appeler le fournisseur de charbon pour lui en commander mais la ligne était occupée. Elle ne s’est libérée qu’il y a une minute. »
Virevoltant tout près du corps de mon père, se trouvaient les anges de poinsettias. Noël était une des rares journées de congé de mon père, étant donné que la pharmacie était ouverte six jours sur sept, et que le dimanche, il y allait immanquablement quelques heures pour terminer le travail de la semaine précédente. Mais plutôt que de se reposer à Noël, jour où, en tant que Juif, il n’avait rien de spécial à faire, mon père chargeait l’arrière de son break de poinsettias, fleurs appelées couramment étoiles-de-Noël. Puis il allait les offrir aux femmes pauvres qui vivaient dans les quartiers noir et portoricain situés près de sa pharmacie.
Quand mon frère Joe était adolescent, c’est lui qui avait l’habitude de les porter dans les maisons. Beaucoup de ces femmes, sans mari et devant s’occuper d’une marmaille d’enfants, lui disaient que c’était la seule belle chose qu’elles recevaient tout au long de l’année.
Une de ces femmes était atteinte de sclérose en plaques. Elle vivait dans une maison de santé. Tous les ans, Joe lui apportait les fleurs dans sa chambre, les plaçait sur sa table de chevet et marmonnait : « Joyeux Noël », pendant que la pauvre femme paralysée le suivait des yeux, incapable de le remercier ne serait-ce que par un hochement de tête. Un certain Noël, Joe finit par interroger les infirmières qui s’occupaient d’elle quant à son identité. Celles-ci lui racontèrent qu’elle était la fille d’une famille aisée et qu’elle avait contracté cette maladie au moment où elle devait se marier. Son futur époux avait rompu les fiançailles et sa fortune avait été utilisée pour les médecins et les traitements. En fin de compte, même sa famille avait coupé tout contact avec elle. Elle ne recevait au cours de l’année ni lettre, ni carte postale, ni cadeau à l’exception de ces poinsettias que mon père lui envoyait.
Après le départ de Joe pour l’université, mon père prit la relève de la distribution de poinsettias. En dépit de son embonpoint ainsi que de divers problèmes de santé dont il souffrait comme des varices ou de l’arthrite, mon père se chargea de livrer ces poinsettias jusqu’à sa retraite, qu’il prit à l’âge de soixante-quinze ans.
Dans un coin de la pièce mortuaire, se tenaient des anges de bibliothèque.
Dans un coin de la pièce mortuaire, se tenaient des anges de bibliothèque. Après avoir pris sa retraite, mon père se porta volontaire à la bibliothèque du quartier pour apporter des livres à des personnes confinées à domicile. S’appuyant sur sa canne et claudiquant en raison de son arthrite, il devait souvent grimper plusieurs volées d’escaliers pour atteindre des logements misérables habitées par des personnes généralement plus jeunes et parfois moins handicapées que lui, qui n’avaient plus aucune raison de se lever le matin.
Mon père était sensible aux problèmes de chacun. Cet homme souffrait-il de douleurs du dos ? Sur-le-champ, sans même prendre de rendez-vous, il le conduisait chez son propre médecin. Cette femme avait-elle l’impression qu’elle ne comptait pour personne? Mon père s’arrangeait pour l’emmener voter le jour des élections, en la convainquant de l’importance de sa voix.
Mon père vivait dans un monde où les étrangers n’existaient pas. Il était incapable de faire la queue dans un supermarché ou d’être attablé dans un restaurant sans engager la discussion avec la personne se trouvant près de lui. Sa désinvolture extrême à l’égard de la vie privée des autres me mettait toujours mal à l’aise. Qui sait, ce jeune Irlandais de la table voisine ne préférait-il pas bavarder avec sa famille plutôt qu’avec ce Juif chauve avec qui il n’avait rien de commun ?
Et pourtant, mon père trouvait invariablement un point commun. Soit l’Irlandais avait un oncle pharmacien comme lui, soit il avait une tante qui avait étudié avec sa grand-tante en 1929, soit il avait comme pédiatre quand il était enfant le Dr. Hanson, son vieux camarade de lycée, soit enfin il avait été en villégiature dans le même endroit où notre père nous avait emmené une fois en été. Le temps que la serveuse nous apporte l’addition ou que nous atteignions la caisse dans la queue du supermarché, les étrangers souriaient aussi chaleureusement que s’ils avaient retrouvé un vieil oncle perdu de vue depuis longtemps. Mon père ne savait-il pas que dans cette deuxième moitié du vingtième siècle, la mentalité prédominante dans la société était de s’éloigner d’autrui ?
En fait, bien que mon père ait vécu tous ses quatre-vingt six ans au vingtième siècle, il n’en fit jamais partie. Quand j’étais major de ma promotion en psychologie, à l’université de Brandeis, j’eus un débat avec lui au sujet d’un certain problème sociologique. Il me stupéfia en déclarant qu’il ne croyait pas en la sociologie ni en la psychologie. J’étais sidérée. La sociologie était-elle donc une espèce de théorie religieuse nébuleuse en laquelle on pouvait choisir de croire ou non ?
Quand, dans les années 60, enflammée par mes convictions politiques de gauche, je tonnais contre l’oppression subie par les classes défavorisées, en citant à l’appui des statistiques de famine dans la riche Amérique, mon père me rétorquait avec colère : « Sornettes ! Si quelqu’un a faim à Camden, il n’a qu’à venir chez moi ou chez le pasteur du presbytère, rue Stevens. »
Pour mon père, que des problèmes sociaux ne puissent pas être résolus par un voisin bon et généreux dépassait l’entendement. Quarante ans plus tard, je me demande s’il n’avait pas raison.
À Brandeis, j’appartenais à l’Association de gauche des étudiants pour une société démocratique. Je militais pour les minorités et les paysans opprimés du tiers-monde face à l’établissement bourgeois conservateur d’Amérique. Par conséquent, je fus perplexe quand je vis une fois en entrant dans la pharmacie de mon père, une jeune fille noire lui demandant à voix basse de lui parler en privé.
Si à mes yeux, mon père incarnait l’ennemi du système que je prônais, pourquoi cette adolescente n’était pas de cet avis ?
Je lui demandais plus tard ce qu’elle voulait. Il me répondit sans avoir l’air d’y attacher de l’importance (car cela devait être quelque chose de courant), qu’elle pensait avoir attrapé une maladie vénérienne et qu’elle lui demandait ce qu’elle devait faire. Comment se faisait-il qu’une jeune adolescente noire, à l’époque des Black Panthers, puisse se confier à un pharmacien juif, blanc, bourgeois et républicain ? Si à mes yeux, mon père incarnait l’ennemi du système que je prônais, pourquoi cette adolescente n’était pas de cet avis ?
Une autre fois, j’entrai avec lui dans la pharmacie par une matinée d’été. Cinq ou six mères de famille noires, assises devant le distributeur de soda, accueillirent mon père avec des sifflets et des récriminations :
« On veut plus vous causer, M’sieur Levinsky. »
« Vous nous avez causé de sacrés ennuis, Doc. »
Je me demandais de quelle façon le tempérament bourru et fougueux de mon père avait pu heurter ou insulter ces femmes. Il les ignora et se dirigea directement vers le comptoir des prescriptions. Pour ma part, je fus préoccupée par leurs revendications. Je m’approchai d’elle et leur demandai ce que mon père avait pu leur faire.
L’une d’elles me répondit : « Hier après-midi, il a demandé au type des glaces de distribuer des glaces à l’eau à tous les gosses de notre bloc et c’est lui qui a tout payé. Nous, on a été obligées de passer tout l’après-midi à ramasser les emballages. Alors c’est fini, on veut plus lui causer. » Et sur ces mots, ces femmes sont parties d’un grand éclat de rire.
Quand, dans les années 70, des émeutes raciales secouèrent les grandes villes américaines, le centre-ville de Camden fut également dévasté. Commençant par une des extrémités de Broadway, dans la rue principale, les émeutiers incendièrent et pillèrent pratiquement tous les magasins. Ils mirent le feu à la bijouterie attenant l’officine de mon père, la rasant entièrement. Puis vint le tour de la pharmacie. Selon un témoignage visuel, un des émeutiers se mit à crier : « N’y touchez pas. C’est un ami à nous. » La foule en colère passa au magasin suivant, en brisa les vitres et le mit à sac. Quand la fumée se dissipa le lendemain, son drugstore fut le seul magasin qui ressortit entièrement intact. Un hommage, aussi effrayant que touchant, rendu au « Doc », comme ils appelaient mon père.
Mon père alla à la banque et emprunta 4000 dollars dont il fit don au Fonds d’Urgence pour Israël.
Mon père n’était pas riche mais il donnait de l’argent ou en prêtait comme s’il en avait. Pendant la guerre des Six jours, lorsque la communauté juive américaine se rassembla pour pourvoir aux besoins urgents d’Israël, mon père, dont les deux enfants étudiaient dans des universités privées très chères, constata qu’il n’avait pas d’argent à donner à Israël. Il se rendit à la banque et emprunta 4000 dollars dont il fit don au Fonds d’Urgence pour Israël. Plus tard, lorsque la communauté juive locale fit une collecte au profit d’une clinique gériatrique, mon père hypothéqua sa maison afin d’avoir une somme correcte à contribuer.
Mon père avait l’habitude de prêter de l’argent à n’importe quel client du drugstore qui le lui demandait. La plupart de ces prêts ne furent jamais remboursés. Lors de la semaine de deuil, la chiva, Carl, le pharmacien italien qui lui avait racheté son commerce, nous raconta que quand mon père lui avait transmis les clefs, ils tombèrent sur un carnet épais, rempli de chiffres. Carl lui demanda ce que c’était. Mon père lui répondit qu’il s’agissait du registre des prêts impayés. Carl lui demanda à combien s’élevait le total. Jetant le carnet dans la corbeille, mon père répondit en haussant les épaules : « C’est inestimable. »
Mon père était né en 1902, une année seulement après que ses parents émigrèrent d’Odessa. Il n’avait que dix-sept ans de différence avec sa mère. Alors qu’il avait plus de soixante ans, je me souviens d’avoir vu ce grand gaillard d’un mètre quatre-vingt, le peu de cheveux lui restant complètement gris, s’occuper avec sollicitude de sa mère âgée de quatre-vingts ans. Combien de fois observais-je avec respect comment mon père acceptait sans mot dire les reproches acerbes que lui faisait ma grand-mère. Mon père prenait en charge l’appartement de trois pièces de sa mère et une aide ménagère à plein temps. Quand il avait fini sa journée de travail de dix ou douze heures, il allait presque chaque jour prendre des nouvelles de sa mère et s’assurer qu’elle avait tout ce dont elle avait besoin. Ma mère l’attendait pour servir le dîner quand il rentrait après 19 heures.
Mon père assumait également la responsabilité de Nana, ma grand-mère maternelle. Quand mes parents firent construire leur maison de rêve en banlieue, ils réservèrent une pièce pour Nana, laquelle était atteinte de la maladie de Parkinson. Ma mère se chargeait de l’habiller, de la laver et de prendre soin d’elle tandis que mon père assumait ses dépenses tout naturellement. Aux obsèques de Nana, le rabbin fit l’éloge des soins sans bornes que mon père prodigua à sa belle-mère. Ma mère, en larmes tout le long de l’enterrement, dit plus tard qu’elle eut envie à ce moment-là de se lever et d’applaudir.
Ma mère, en larmes tout le long de l’enterrement, dit plus tard qu’elle eut envie à ce moment-là de se lever et d’applaudir.
Lorsque Carl racheta la pharmacie, son avocat et celui de mon père dressèrent l’acte de vente. Après la signature, alors qu’ils rejoignaient leur voiture, l’avocat de Carl lui dit : « Vous venez de perdre votre argent. »
Carl tressaillit. Et l’avocat de s’expliquer : « Avec un tel homme, une simple poignée de mains aurait suffi. »
Le lendemain du décès de mon père, son rabbin vint discuter avec nous en vue de l’enterrement. Bien entendu, il connaissait très bien mon père, car Irving (Israël) avait été un habitué de la synagogue et accompagnait ma mère chaque Chabbat aux offices. Néanmoins, le rabbin demanda aux membres de la famille rassemblés dans le salon s’il y avait quelque chose de particulier que nous voulions qu’il mentionne dans son éloge funèbre.
Des choses incroyables furent alors révélées. Chaque membre de la famille se mit à raconter une anecdote sur les actes de bonté de mon père dont il avait été lui-même témoin, et que les autres entendaient pour la première fois. Mon père n’en avait jamais parlé, pas même à ma mère. Tous le décrivaient comme un bonhomme bourru, soupe au lait, et à la voix tonitruante. Visiblement, ses qualités étaient aussi cachées que ses défauts étaient évidents. Nous savions qu’il était généreux et qu’il avait aidé beaucoup de personnes mais, même ceux qui lui étaient le plus proches, ignoraient à quel point il avait prêté de l’argent, trouvé des emplois, secouru tant de personnes.
Mon père ne croyait ni à l’âme éternelle ni au monde futur. Il n’attendait aucune récompense pour avoir pris en stop des gens quand il pleuvait ou pour avoir trouvé des emplois aux enfants de ses clients du ghetto. Combien dut-il être ébahi de se voir ainsi monter au Ciel, escorté par une légion d’anges familiers. Absorbée par mes méditations près de son corps dans cette froide chambre mortuaire, je me surpris à annoncer : « Surprise, Papa ! »
Mais j’eus aussi une révélation dans cette salle peuplée de tant d’anges. Je vis que ce sont les actes qui comptent essentiellement. Bien que je pratique la Tora depuis plusieurs années et que je sache que le judaïsme est une religion qui subordonne la foi à l’action, à l’accomplissement des mitsvot concrètes, je préférais vivre dans le royaume éthéré de l’esprit et de l’intelligence. Debout à côté du corps de mon père, fixant son visage lumineux, je fus bouleversée de constater qu’il était devenu ce qu’il était par la seule vertu de ses actes.
Le chemin menant mon père au paradis fut pavé de poinsettias et d’emballages de glace à l’eau. Et s’il y avait un fossé entre la foi qu’il n’avait pas eue et les mitsvot qu’il n’avait jamais appris à pratiquer, l’espace en avait été comblé, comme par un immense pont, par le carnet de prêts qu’il avait jeté.
Moi qui avais passé 42 ans de ma vie à lutter avec des concepts profonds et des aspirations élevées, ne pouvais trouver dans mon entourage un acte tel que la commande de charbon pour cette femme malade. Et j’eus l’impression de voir mon père me faisant à moi, sa fille religieuse, un clin d’œil depuis la place d’honneur qui lui est réservée dans l’autre monde et me disant : « Surprise ! »
Écrit pour l’élévation de l’âme de mon père, Yisraël ben Yosef Yehouda.